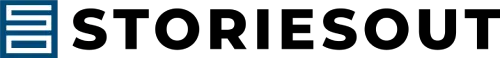Origine : un outil né de la professionnalisation du journalisme
La carte de presse – ou plus précisément carte d’identité de journaliste professionnel – est un document officiel créé en France en 1935. Sa mise en place répondait à un besoin clair : distinguer les journalistes professionnels des autres producteurs de contenu, dans un contexte où la presse prenait de plus en plus de poids dans la vie démocratique.
Elle est aujourd’hui délivrée par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP), une instance paritaire indépendante qui veille à encadrer l’accès à cette reconnaissance.
Qui peut obtenir une carte de presse et comment ?
Contrairement à une idée reçue, la carte de presse n’est pas un diplôme ni un droit automatique.
Pour l’obtenir, il faut :
- Exercer une activité de journaliste à titre principal et rémunéré, dans un ou plusieurs médias reconnus.
- Consacrer au moins 50 % de son activité à la production d’informations à destination du public.
- Fournir les justificatifs de cette activité (contrats, bulletins de salaire, publications…).
Chaque demande est examinée par la CCIJP, qui délivre la carte pour un an renouvelable. Elle peut être retirée si les critères ne sont plus remplis.
À quoi sert-elle ?
La carte de presse ouvre des droits et facilite l’exercice du métier :
- Accès facilité à certains événements (conférences de presse, institutions, festivals, salons…)
- Accès libre à certaines zones lors de manifestations ou de situations sensibles (sous réserve des décisions préfectorales)
- Exonérations fiscales partielles, liées aux frais professionnels
- Accès à des tarifs réduits (transports, cinéma, musées…) – un avantage annexe, certes, mais bien connu
Mais son rôle principal reste déontologique : elle atteste que son détenteur respecte un cadre professionnel précis, encadré par la loi et des règles éthiques.
Quelles sont les limites de son influence ?
La carte de presse n’est ni une immunité, ni une autorisation absolue. Elle ne protège pas d’une garde à vue ni ne garantit un accès systématique à toutes les sources ou lieux d’information.
Elle ne confère pas non plus une autorité éditoriale. Un journaliste peut être détenteur de la carte et travailler dans des conditions très diverses, selon la ligne éditoriale de son média, ses pratiques, ou ses choix personnels.
Enfin, elle ne protège pas contre les critiques, surtout à l’ère des réseaux sociaux, où l’expertise journalistique est parfois mise en cause.
Carte de presse et relations presse : quels sont les liens ?
Pour les professionnels des relations presse, comprendre le fonctionnement de la carte est essentiel.
D’abord, parce qu’elle permet d’identifier les journalistes professionnels. Eux seuls sont amenés à traiter une information dans un cadre rédactionnel structuré, avec des obligations de rigueur, de vérification et de diffusion impartiale.
Ensuite, parce qu’en tant que chargé·e de RP, vous n’avez pas de carte de presse – et ce, même si vous écrivez beaucoup, si vous êtes un ancien journaliste, ou si vous travaillez dans une agence. La frontière est claire : vous êtes un émetteur, pas un médiateur.
Enfin, parce que lors de l’organisation d’un événement ou d’un envoi de communiqués, savoir à qui vous vous adressez (presse pro, blogueur, influenceur, pigiste sans carte, etc.) est une compétence stratégique. Le ton, les attentes, la temporalité… varient.
Conclusion : la carte de presse, outil de distinction, pas de pouvoir
La carte de presse reste aujourd’hui un repère utile dans un paysage médiatique mouvant. Elle ne dit pas tout d’un journaliste, mais elle atteste d’un engagement professionnel dans la production d’information.
Pour les RP, elle n’est pas un objectif ni un statut à convoiter, mais un outil de compréhension : savoir à qui l’on parle, pourquoi, et comment construire une relation respectueuse et efficace.