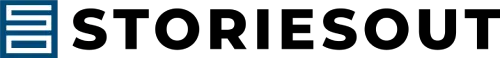1. Une origine ancienne, un principe simple
La revue de presse est presque aussi ancienne que la presse elle-même. Dès la fin du XIXe siècle, les ministères, les grandes entreprises et les cabinets politiques faisaient compiler des extraits de journaux pour suivre l’évolution des opinions, des tendances ou des polémiques.
Aujourd’hui, le principe reste inchangé : il s’agit de sélectionner, résumer et organiser les contenus médiatiques (articles, interviews, éditos, chroniques…) autour d’un thème, d’un acteur ou d’un événement.
2. À quoi sert une revue de presse ?
- À s’informer efficacement : la revue de presse permet de suivre en un coup d’œil ce que la presse dit d’un sujet sans avoir à tout lire.
- À contextualiser l’actualité : elle met en lumière les angles choisis par les médias, les différences de ton ou de traitement.
- À nourrir la stratégie de communication : en analysant la perception médiatique d’un sujet, on affine son message.
La revue de presse est en réalité un instantané de l’actualité – telle qu’elle est traitée dans les médias – sur un sujet donné. Et le mot “instantané” est important : la durée de vie de cet outil est limitée et l’exercice doit être régulièrement recommencé de zéro.
À noter : l’obsolescence de la revue de presse était déjà une réalité au temps de la presse écrite puis audiovisuelle. A l’heure d’Internet, avec l’infobésité qu’il a créé, cette obsolescence est devenue d’autant plus prégnante.
3. Qui produit une revue de presse, et pour qui ?
Les revues de presse peuvent être réalisées :
- En interne, par un·e chargé·e de communication, de veille ou de relations presse.
- Par des agences spécialisées en veille médiatique.
- Par les équipes RP elles-mêmes, notamment dans les top 10 agences relations presse, où cela fait partie des livrables classiques.
Mais surtout, les destinataires ne sont pas les mêmes et ne l’utilisent pas de la même manière.
Direction générale
Elle y voit un indicateur de perception externe. Cela l’aide à ajuster son positionnement, sa communication institutionnelle ou ses choix de prise de parole publique. En effet, un article critique dans Les Échos ou Le Monde ne pèse pas pareil qu’un éloge dans un blog de niche.
Porte-paroles et dirigeants opérationnels
Ils utilisent la revue de presse pour préparer leurs interventions, affiner leurs éléments de langage, anticiper les questions sensibles. C’est un outil de brief tactique, souvent enrichi d’un filtre thématique (“ce qui est dit sur nos produits”, “ce que dit la concurrence”, “les signaux faibles réglementaires”…).
Équipes commerciales ou marketing
Elles s’appuient sur les mentions positives pour valoriser les retombées RP dans leurs présentations clients, dans les appels d’offres, ou en interne pour montrer la dynamique de notoriété.
Partenaires, investisseurs ou actionnaires
Une revue de presse ciblée renforce la confiance et alimente les discussions stratégiques. Elle montre que l’entreprise est suivie, crédible, active ou qu’elle doit travailler sa présence.
Collectivités et institutions
La revue de presse est souvent utilisée pour documenter la visibilité de leurs actions publiques (subventions, projets, prises de parole officielles) et nourrir les bilans d’activité. Dans ces contextes, elle peut aussi servir de base pour le dialogue avec les élus ou les citoyens.
Clients d’agences RP
Pour eux, c’est souvent le livrable le plus visible du travail réalisé. Il donne corps aux résultats, structure les reporting et sert de point d’appui pour décider des ajustements de stratégie.
En résumé, une revue de presse bien construite n’est jamais générique : elle doit être pensée en fonction des usages concrets qu’en feront ses destinataires. L’enjeu n’est pas de tout montrer, mais de mettre en lumière ce qui compte vraiment.
4. Quelle utilité en relations presse ?
Dans le cadre des relations presse, la revue de presse est un baromètre d’efficacité :
- Elle permet de mesurer la visibilité obtenue après une campagne médiatique.
- Elle identifie les titres qui relaient l’information, leur audience, leur tonalité.
- Elle constitue un outil de preuve pour le client, qui visualise immédiatement le retour de ses investissements en RP.
Certaines agences y ajoutent un commentaire stratégique : quelles tendances émergent ? quels journalistes semblent les plus réactifs ? où se situent les résistances ou les silences ?
5. QQue devient la revue de presse avec l’arrivée du web ?
Avec l’arrivée des sites d’info en ligne, la revue de presse a dû se réinventer :
- Explosion des contenus : il ne s’agit plus de compiler 10 articles imprimés, mais parfois 50 liens ou citations dans des formats variés (texte, podcast, vidéo…).
- Temps réel : la veille n’est plus hebdomadaire, elle est continue.
- Mesure d’impact digitale : les vues, partages, commentaires, backlinks… entrent en ligne de compte.
Certaines revues de presse sont devenues des dashboards dynamiques, d’autres restent sous forme de PDF contextualisés, selon les publics et les besoins.
6. Et les IA dans tout ça ?
L’intelligence artificielle transforme en profondeur la création de revues de presse :
- Détection automatique des mentions d’une marque, d’un nom ou d’un mot-clé.
- Classement sémantique selon la tonalité ou le type de média.
- Résumés automatisés en langage naturel.
- Traduction en temps réel de contenus étrangers.
Mais attention : si l’IA gagne en pertinence, l’analyse humaine reste indispensable pour détecter l’ironie, la nuance éditoriale ou les sous-entendus culturels. Une IA vous dira que vous êtes mentionné. Un bon chargé de RP vous dira comment vous êtes perçu.
7. Conclusion : la revue de presse, un outil vivant, pas une formalité
La revue de presse n’est pas un simple fichier à envoyer chaque lundi matin. C’est un outil stratégique de compréhension, qui reflète l’image d’un acteur, d’une marque ou d’un sujet dans le miroir médiatique.
À l’heure de l’instantanéité, de la complexité des canaux et de l’automatisation, elle reste un levier d’influence majeur, à condition d’être bien pensée, bien ciblée, et intelligemment analysée.